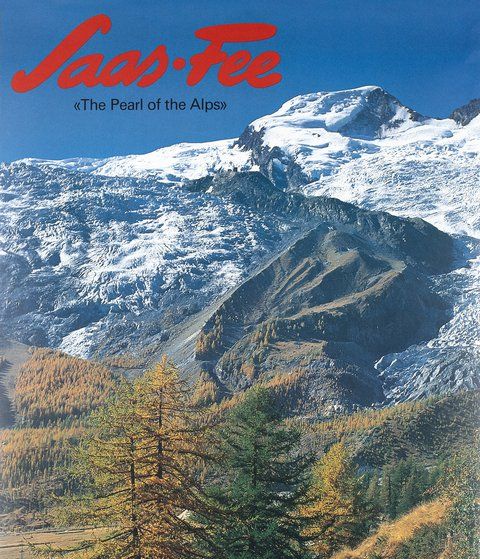Il y a quelques jours, j’étais allongé sur une chaise, la tête au-dessous du niveau des pieds, et deux personnes tentaient par tous les moyens d’insérer divers outils dans mon orifice buccal en vue de m’administrer des soins dentaires. Une fraise de dentiste, à qui je n’avais pourtant rien fait de mal, s’ingéniait à creuser dans mon maxillaire supérieur avec des effets rien moins qu’agréables pour votre serviteur. C’est à ce moment que je me suis demandé ce qui se passerait si un génie malfaisant (ou exagérément facétieux, c’est selon) coupait l’alimentation en électricité du cabinet dentaire.
Contrairement aux blocs chirurgicaux hospitaliers, les sites de soins dentaires sont peu protégés contre des interruptions d’alimentation, car souvent situés dans des appartements réaménagés à cet effet. Une coupure de l’alimentation interrompt donc instantanément le fonctionnement de tous les outils du cabinet dentaire, ce qui eût laissé le patient (moi-même en l’occurrence) littéralement bouche bée. Il y a de nombreuses autres circonstances qui pourraient s’avérer cocasses, ou critiques selon les cas. Comment cela se passe-t-il dans un ascenseur, par exemple ? Qu’en est-il du nombre de plus en plus élevé de transactions en ligne (bancaires, commerciales, de téléachat) qui se trouvent interrompues dans un état pas trop déterminé, même si l’on utilise un ordinateur portable muni d’une batterie : le routeur d’accès est rarement protégé, lui. Et ne comptons pas trop sur nos chers et indispensables intelliphones : le réseau 4G ou 5G ne résiste pas très longtemps à une panne de courant. Les opérateurs parlent d’une heure d’autonomie pour les antennes, je peux imaginer qu’après la moitié de ce temps surgissent les premières défaillances. On ne fera que mentionner les feux tricolores de circulation souvent commandés par un système de régulation informatique complexe depuis une centrale truffée d’ordinateurs et d’écrans de visualisation du plus bel effet…
Cette problématique a toujours été présente ; mais on avait fini par la cacher sous le tapis. Fin juin 2022, le conseiller fédéral Guy Parmelin demandait aux Suisses de se préparer à baisser le chauffage en raison de pénuries prévisibles de gaz à partir de l’hiver prochain. Les citoyens suisses, confiants dans la sagesse de leur gouvernement, l’ont cru; mais comme les Suisses sont apparemment aussi assez frileux, ils ont pris proactivement d’autres mesures pour se préparer à l’hiver : ils ont fait l’acquisition massive de radiateurs électriques. Et dans le même temps, les autorités mettaient en garde la population contre les canicules à venir, ce qui a incité les gens à l’acquisition de climatiseurs bon marché et puissamment énergivores.
Le petit problème, c’est que les distributeurs d’électricité se font aussi du souci pour l’approvisionnement en énergie électrique cet hiver. L’annonce du conseiller fédéral Parmelin est un véritable appel à la surconsommation électrique, et donc au black-out que l’on voulait en principe éviter. On ne peut s’empêcher de penser que le gouvernement a un peu perdu la maîtrise du sujet, si tant est qu’il n’ait jamais possédé cette maîtrise d’ailleurs. Il n’est que de se souvenir du discours de madame Leuthard sur l’abandon des centrales nucléaires qui fut certes applaudi dans le contexte de Fukushima, mais qu’aucune mesure de remplacement ne vint compléter. Concrètement, on a décidé de supprimer plus de 30% des sources d’approvisionnement en énergie électrique du pays sans se donner la peine de réfléchir à ce qui allait remplacer ce déficit. Quelque part, l’inconscient collectif a imaginé que l’on pourrait acquérir l’énergie auprès de la France voisine, qui n’a pas encore jeté ses centrales nucléaires au rebut et ne s’apprête pas à le faire ; mauvaise pioche (indépendamment du caractère cynique de la réflexion) , car pas mal de centrales nucléaires de nos voisins sont en révision technique, actuellement.
Je sais, je me répète (l’âge, sans doute…), mais « Gouverner, c’est prévoir… » (Emile de Girardin). Mais pour un politicien, gouverner, c’est avant tout parler; pour agir, on verra plus tard, éventuellement après les élections; ou après la législature en cours; peut-être que le successeur aura le bon goût de s’en occuper, ou n’aura pas le choix de ne pas s’en occuper. Dans l’immédiat, il suffit de parler, occuper la scène oratoire et les médias par un discours qui sera jugé adéquat par la majorité électrice soucieuse de son confort.
De nombreuses personnalités de tous bords ont développé sur ce sujet une pathologie bien connue, mais assez mal documentée : l’incontinence verbale, plus difficile à contenir que l’incontinence urinaire, car une couche-culotte plus ou moins discrète ne suffit pas. Elle se manifeste par une logorrhée surabondante, et souvent assez nauséabonde et dépourvue d’intérêt pratique. Dans le domaine qui nous intéresse, il s’agit de marteler au consommateur le message selon lequel il consomme trop (de gaz, d’eau, d’électricité, d’essence, de viande, de fuel, d’air respirable, d’espace) et de lui donner de bons (?) conseils pour économiser. Ce n’est pas propre à la Suisse d’ailleurs ! Pour illustrer le discours, on va proposer des mesures cosmétiques, histoire de laisser à penser que l’on « fait quelque chose ». On va encourager les gens à installer des pompes à chaleur, alors que tout le monde est en rupture de stock; on va proposer l’installation de panneaux solaires, alors qu’ils ne sont pas livrables, ou respectivement que l’on ne peut les raccorder au réseau faute d’onduleurs.
Dans le domaine des mesures cosmétiques peu efficaces, nos voisins de France ne sont pas beaucoup plus inspirés ; le gouvernement français lutte contre le renchérissement du prix des carburants en finançant l’essence sur les deniers publics : une politique qui favorise les véhicules à grosse consommation (qui récupèrent proportionnellement plus de financement de l’Etat), et accessoirement les frontaliers genevois qui vont faire le plein en France voisine. On conseille aux gens de prendre les transports publics, on veut favoriser la mobilité douce, mais on n’a guère de scrupules à importer des véhicules affichant une puissance absurde et capables de vitesses délirantes, totalement inadéquates sur une route ouverte.
Selon diverses sources, Internet serait le plus gros pollueur de la planète (ou est en passe de le devenir). Bien sûr, ce n’est pas Internet par lui-même qui est pollueur, c’est les applications que l’on développe sur l’infrastructure; mais beaucoup tendent à confondre les deux aspects. Un courriel ne consomme pas grand-chose; un million de messages réclament déjà un peu plus d’énergie. Mais quand on sait que 70 à 80% de ces messages sont des messages non sollicités (pourriels, spams), on se demande pourquoi personne ne fait rien pour les bloquer à la source ! On se contente de les bloquer à l’arrivée, lorsqu’ils ont déjà consommé des ressources; et il n’y a même pas de législation envisagée pour limiter le phénomène, alors même que ces pourriels convoient également la quasi totalité des arnaques sur Internet.
Les principaux responsables de la surconsommation d’Internet seraient le streaming et les data center. On oublie peut-être un peu facilement les cryptomonnaies, qui représentent un poids considérable dans la consommation des infrastructures Internet; mais quelqu’un parle-t-il de réglementer la diffusion de « House of the Dragon » ? Des « Anneaux de Pouvoir » ? Pas si bête, cela rapporte bien trop d’argent…
Il y aura probablement des pénuries, certaines aboutiront peut-être à des situations cocasses ou tragiques. Mais ce sera votre faute, vous autres qui consommez trop et ne posez pas de couvercle sur la casserole pour chauffer l’eau; ce ne sera pas la faute des responsables politiques qui n’ont rien entrepris à l’époque pour favoriser une transition en douceur, alors même que le contexte géopolitique était favorable. Alors que maintenant, en situation de guerre en Europe, le problème est forcément d’un abord plus délicat…